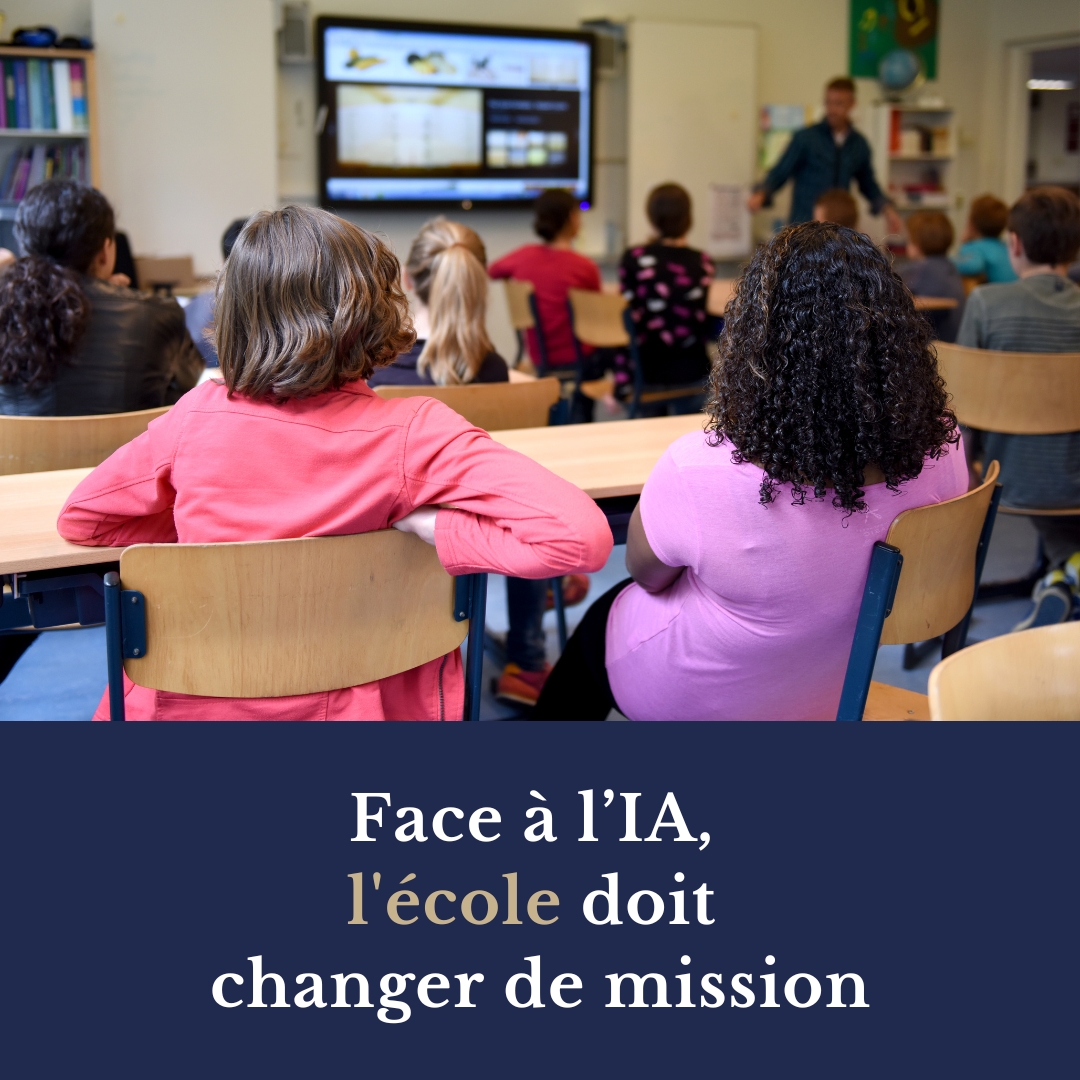L’école suffoque, mais pas pour les raisons qu’on croit.
En septembre 2024, plus de 56 % des collèges et lycées manquaient d’au moins un professeur. Depuis plusieurs années, l’Éducation nationale étouffe. Les enseignants, eux, ont cessé de rêver. Mal payés, mutés à l’autre bout de la France, moqués, agressés, ils sont désabusés et vidés de leur foi. Ce qui fut longtemps une vocation se transforme aujourd’hui, au mieux, en impasse ; au pire, en sacrifice.
À cette crise visible s’ajoute une autre, plus silencieuse : l’obsolescence rapide de nos savoir-faire techniques.
Dans les métiers du digital (marketing, IA, UX, SEO, développement) la durée de vie d’une compétence dépasse rarement deux ans. Ce n’est pas nouveau, mais l’arrivée de l’intelligence artificielle a accéléré le phénomène. Elle rebat les cartes de nos carrières, de nos formations, de nos repères.
Le modèle linéaire “j’étudie puis je travaille” s’effondre. Il laisse place à une dynamique continue : je travaille, j’apprends, je me réinvente, encore et encore. La valeur réside désormais dans la capacité à orchestrer, questionner, sélectionner, créer. En d’autres termes : dans la part profondément humaine de notre intelligence.
Derrière la crise de l’École, il y a donc surtout une crise de nos compétences et c’est elle qui redéfinit la mission même de l’institution.
Alors, l’école vit-elle son dernier souffle ? Est-il encore possible d’éviter qu’elle suffoque ?
Je ne le crois pas. Mais à condition de regarder en face ce qui a réellement changé.
Car si le diplôme n’a plus la suprématie qu’il avait autrefois, il reste néanmoins un point d’ancrage dans les secteurs réglementés, la fonction publique ou les métiers “à statut”. Une garantie de cadre, de niveau, de socialisation professionnelle.
Il n’est pas mort, il n’est simplement plus suffisant.
C’est précisément cette transformation de la valeur qui oblige à repenser le rôle de l’École. Analyser, s’adapter, créer, juger : ce sont désormais ces compétences-là qui permettent de maîtriser les outils, les mutations et les ruptures. Ce sont elles, surtout, qui constituent le véritable capital.
L’enjeu éducatif du XXIe siècle n’est donc pas de sauver l’École telle qu’elle était, mais de transformer la manière d’apprendre, pour préparer les élèves à un monde où l’intelligence artificielle amplifie… l’intelligence humaine.
Un défi immense. Et passionnant.
Sommaire
La fin des compétences durables
Dans les métiers du digital, une compétence technique vit deux ans.
Parfois moins.
Je l’ai vécu de l’intérieur pendant vingt ans.
2005.
Fraîchement diplômée de l’ESAAT, j’ai vingt ans et une trajectoire en tête : graphiste, puis directrice artistique, puis un jour, qui sait, dirigeante d’agence. Le marché était déjà serré, mais les métiers créatifs avaient encore une certaine stabilité. Je travaillais beaucoup, j’apprenais vite, et je pensais que mes compétences me porteraient loin.
Puis juin 2007 arrive : le premier iPhone.
En quelques mois, tout un pan de mon métier bascule.
De nouvelles expertises émergent : UX design, ergonomie, design d’interfaces et prennent une place considérable dans les agences. Je comprends vite que rester graphiste « print » me condamnera.
Je me forme, je m’adapte : UX design, HTML5, CSS3, Javascript, puis les premiers outils No Code et WordPress.
Je deviens webdesigner presque malgré moi.
Mes ambitions initiales s’éloignent, mais d’autres se dessinent.
Cette capacité d’adaptation, je la vois aujourd’hui comme une force… mais à l’époque, c’était une nécessité vitale.
Septembre 2014 : l’agence dans laquelle je travaille ferme définitivement.
Je me retrouve propulsée freelance, et je cumule les missions : graphiste, illustratrice, webdesigner, intégratrice WordPress. Je n’ai pas le temps de réfléchir à ma trajectoire. Il faut avancer, apprendre, absorber, livrer. Ça fonctionne. Les clients arrivent. Je gagne correctement ma vie.
Puis 2020. Le COVID.
Le marché de l’emploi se fragilise, mes revenus deviennent imprévisibles, et je réalise une chose brutale : je n’ai « que » un bac+2, obsolète. Si demain je dois retrouver un poste salarié, je n’existe plus. Alors je retourne à l’école en parallèle de ma société.
Un bachelor à l’EDHEC : ce n’est pas un BAC +5, mais je vois la renommée de l’école comme une porte d’entrée.
Le diplôme, encore une fois, comme tentative de stabilisation dans un monde instable.
Ensuite 2022.
L’année où l’intelligence artificielle, ChatGPT, DALL·E et les autres, balaie tout sur son passage.
En quelques mois, les métiers de graphiste, d’illustratrice, de webdesigner deviennent vulnérables.
Je tente de résister : personal branding, LinkedIn, growth, nouveaux services.
Je crée une audience de 1 000 à 28 000 abonnés en deux ans.
Je passe de 84 000 € à 120 000 € de chiffre d’affaires.
Sur le papier, je réussis.
Mais intérieurement, je vois bien que quelque chose se fissure.
Chaque mois, un nouveau logiciel à maîtriser : Notion, System.io, Podia, Ausha, WordPress, Mailchimp.
Je deviens tour à tour copywriteuse, cheffe de projet, formatrice, exécutante. Je suis tout et rien à la fois.
Mon métier se dissout dans une succession infinie d’outils et de micro-compétences.
Mes savoir-faire se périment aussi vite qu’ils naissent.
C’est là que j’ai compris quelque chose d’essentiel :
ce que je croyais être une expertise stable n’était qu’une parenthèse.
Chaque innovation m’obligeait à renaître, à recommencer, à reconfigurer ma valeur
Septembre 2024 : j’arrête tout.
Je ferme mon entreprise.
Je veux prendre de la hauteur, je veux comprendre ce qui est en train de se passer, et transmettre. Enseigner.
Revenir au réel, après dix ans de virtualité.
Et refaire surface autrement.
Mais même là, le système me rappelle la nouvelle règle du jeu : mon bac+3 ne suffit pas.
Alors j’obtiens un bac+5 par la VAE, grâce à mes compétences en prompt engineering.
Un diplôme, encore, comme clé d’accès symbolique.
Cette trajectoire n’est pas anecdotique.
Elle illustre ce que beaucoup vivent : des compétences qui s’effritent, un marché qui accélère, et une seule certitude, nous devons tous apprendre à nous réinventer.
Le nouveau rôle des diplômes : utile, mais insuffisant
Si le diplôme a perdu de sa splendeur depuis la massification des masters, il reste un repère.
Une sorte de balise institutionnelle : il rassure, il cadre, il crédibilise. Dans certains secteurs comme la santé, le droit, l’enseignement, la fonction publique, il reste une condition d’entrée, un passage obligé. On peut critiquer son poids, mais il structure encore beaucoup de trajectoires.
Pour autant, ce repère ne suffit plus.Et je le sais mieux que personne.
Quand je me suis retrouvée, en 2020, face à l’incertitude du marché du travail, j’ai réalisé que mon bac+2 de 2005 n’était plus qu’un vieux papier. Si je devais retourner en entreprise, on ne regarderait même pas mes vingt ans d’expérience. J’ai eu beau avoir accompagné plus de 500 entrepreneurs, créé mon entreprise, dirigé des projets digitaux, maîtrisé une dizaine d’outils… sans diplôme “à jour”, je ne valais rien aux yeux de certains recruteurs.
Alors je retourne aux études. Un bachelor à l’EDHEC. J’avais déjà appris mille fois plus sur le terrain mais ce bac+3 me permettait d’ “exister” professionnellement.
Puis, en 2024, j’utilise ChatGPT, mes compétences en prompt engineering, et je monte un dossier de VAE en trois mois.
Résultat : un bac+5, le fameux “Graal” qui m’ouvre les portes de postes à responsabilité.
Mais la vérité ?
Ce diplôme ne m’a absolument pas été utile quand je me suis retrouvée seule, face à 30 élèves, à expliquer le management, la digitalisation, la stratégie.
Le papier rassure, mais il ne remplace ni la pédagogie, ni la clarté, ni l’intelligence de situation.
Aujourd’hui, je le vois autrement : Le diplôme légitime et donne le cadre.
Mais ensuite, tout se joue dans la capacité à évoluer, à se former continuellement, à observer les signaux faibles, à se réinventer sans cesse.
Dans les secteurs réglementés, le diplôme est indispensable : personne ne veut d’un médecin autodidacte ou d’un ingénieur nucléaire “formé sur YouTube”.
Mais dans les secteurs ouverts : digital, communication, marketing, entrepreneuriat, ce qui compte vraiment, c’est la compétence vivante : celle qu’on teste, qu’on ajuste, qu’on met à jour en permanence.
La nouvelle mission de l’École : former des esprits qui s’adaptent
Ce déplacement de la valeur interroge directement la mission de l’École.
Nous ne pouvons plus nous contenter de transmettre des savoirs, comme si la connaissance était un bloc stable et que le reste du monde attendait sagement derrière la porte.
Ce temps-là est révolu.
Les outils, les métiers, les usages, les technologies… tout change trop vite.
Bien trop vite pour qu’un programme figé puisse suivre.
Alors que doit faire l’École ? À quoi doit-elle vraiment préparer ?
Pour moi, la réponse est simple et radicale : former des esprits capables de s’adapter.
Pas des exécutants, pas des techniciens “mis à jour” tous les deux ans, pas des élèves en sursis technologique, mais des individus capables de naviguer dans l’incertitude, d’apprendre vite, d’interpréter ce qu’ils voient, de questionner ce qui semble évident.
1. Apprendre à apprendre
C’est la compétence-mère.
Analyser une situation, comprendre ce qui manque, identifier la ressource utile, l’intégrer rapidement, l’utiliser.
On ne veut plus d’une personne scolaire capable de “retenir un cours”, mais on a besoin d’une personne capable de se mettre en mouvement intellectuel.
Pour ça, il faut être capable de se reconfigurer, de changer d’outil, de méthode, d’approche, sans s’effondrer à chaque nouveauté.
2. Articuler humain + IA
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si les élèves doivent utiliser l’IA, mais comment.
L’enjeu n’est pas de protéger les jeunes de l’IA comme on protège un enfant d’un feu de cheminée.
L’enjeu, c’est de leur apprendre à s’en servir sans s’y perdre : formuler les bonnes questions, vérifier l’information, repérer les biais, recouper, sélectionner, interpréter.
L’IA n’est forte que si l’esprit humain sait la guider.
Le professeur devient alors un maître des questions, pas seulement un maître des réponses.
3. Développer des compétences cognitives durables
En effet, pour moi, les compétences vraiment durables ne sont plus techniques : elles sont cognitives.
La première, c’est la capacité d’analyse du marché du travail : comprendre où vont les métiers, ce qui monte, ce qui disparaît, ce qui se transforme.
Vient ensuite la perception des signaux faibles, cette aptitude à repérer ce qui n’est pas encore visible mais qui va tout changer, une nouvelle technologie, une nouvelle pratique, une nouvelle idée.
À cela s’ajoute la prise de risque : savoir se déplacer, se repositionner, changer de rôle quand le contexte l’exige.
Et bien sûr, la capacité d’adaptation, cette compétence-mère qui permet de pivoter sans perdre pied, d’intégrer des outils nouveaux sans s’y dissoudre.
Puis il y a des compétences plus subtiles : la capacité d’utiliser intelligemment son propre mélange de soft skills et de hard skills selon les situations, ce que peu de formations enseignent, mais que tous les professionnels vivent.
La créativité aussi, pas dans le sens “artistique”, mais comme faculté à imaginer d’autres solutions, d’autres chemins, d’autres façons de faire. Et surtout, il y a la capacité de jugement : distinguer l’utile du bruit, le vrai du superficiel, l’information de l’illusion. C’est cette compétence-là qui fait la différence entre un individu qui subit les mutations et un individu qui les traverse en restant lucide.
Ce sont ces compétences-là qui traversent les époques.
Ce sont elles que ni ChatGPT, ni DALL·E, ni aucune IA ne peut remplacer.
Il y a des élèves qui comprennent une notion parce qu’ils la “savent”, et d’autres qui la comprennent parce qu’ils la pensent.
La différence est immense.
C’est ce que je constate chaque jour : les outils changent, les élèves aussi.
Mais ce qui fait la différence, ce qui les fait grandir réellement, c’est leur capacité à penser, à réfléchir, à se poser des questions, pas seulement à chercher la bonne réponse.
Former des esprits qui savent penser, c’est ça la nouvelle mission de l’École.
Et si l’on réussit cela, alors oui : l’IA pourra amplifier l’intelligence humaine, et non l’étouffer.
L’IA amplifie l’intelligence humaine, pas l’inverse
L’enjeu éducatif du XXIe siècle est devant nous.
Il ne s’agit plus de sauver l’École dans sa forme actuelle, elle est déjà dépassée par la vitesse du monde, mais de la transformer.
De la remettre en mouvement.
De la reconnecter au réel, aux mutations, à la complexité.
L’intelligence artificielle ne remplace pas l’intelligence humaine.
Elle remplace les tâches, les automatismes, les habitudes. Pas la pensée.
Elle amplifie ce que nous sommes déjà : notre créativité, nos angles morts, notre lucidité, nos failles. Elle révèle plus qu’elle ne détruit.
Former des esprits qui savent questionner, sélectionner, comprendre, juger.
Des individus capables de lire un monde qui change trop vite pour qu’on les prépare à tout.
Des élèves qui ne se contentent plus d’apprendre, mais qui savent apprendre à apprendre.
Si nous parvenons à cela, alors non, l’École ne suffoquera pas.
Elle deviendra un lieu où l’on apprend à penser, à s’adapter, à créer.
Le défi est immense, mais il est passionnant.
Et surtout : il est à portée de main, si nous acceptons de regarder le monde tel qu’il est devenu, et pas tel qu’il était hier.