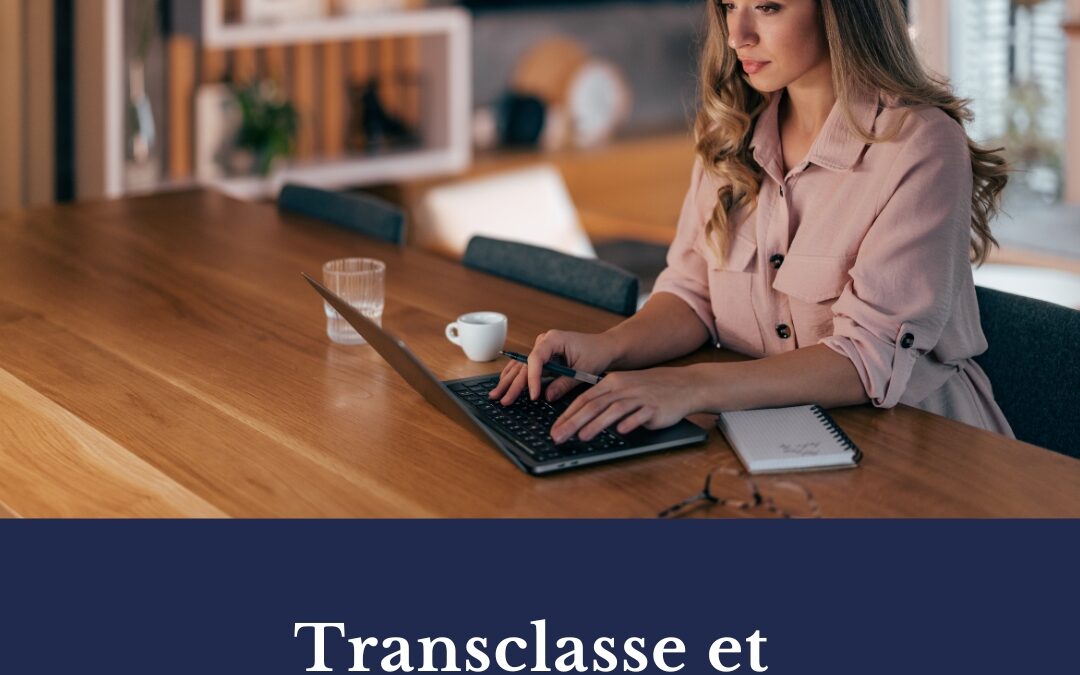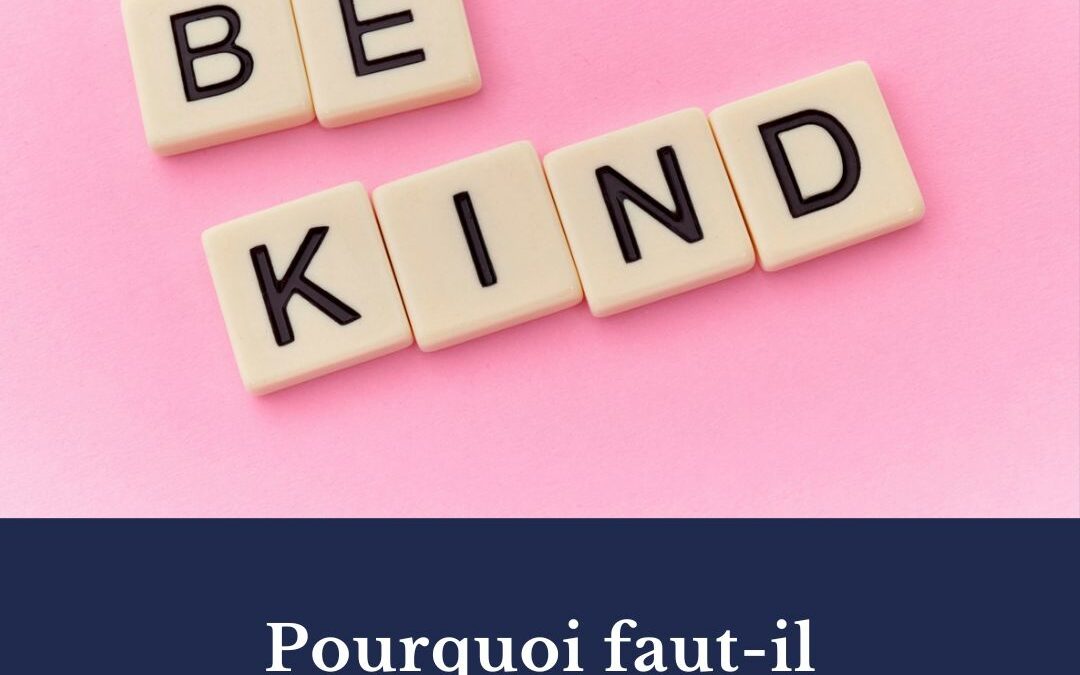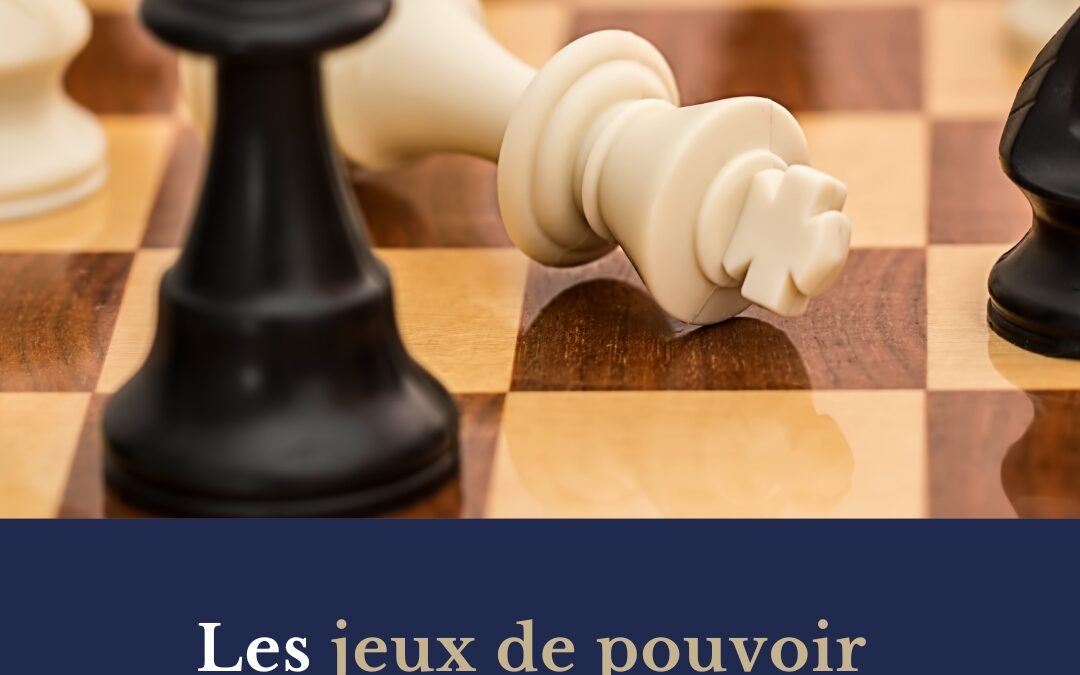
Les jeux de pouvoir au travail
“De tout ce qui est écrit, je n’aime que ce que l’on écrit avec son propre sang. Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit.”
Friedrich Nietzsche – Ainsi parlait Zarathoustra
Il y a 10 ans, j’entrais dans le monde du business.
J’avais à peine 30 ans, et seulement vécu quelques expériences de salariée exécutante. Je n’avais aucune notion de stratégie business, aucun réseau, aucun code, aucune idée des jeux de pouvoir que j’allais découvrir (et subir).
Je débarquais de ma campagne, avec mon bac techno et mon BTS Communication Visuelle. J’étais désireuse de me faire une place dans le monde de la communication.
Je n’avais pas fait d’école de commerce, et je n’avais jusqu’ici pas côtoyé les élites de ce monde. Complètement dans l’utopie du rêve américain, j’étais persuadée que le mythe du « self-made man ou woman » existait. Les dirigeants haut placés qui s’étaient faits seuls m’impressionnaient.
Pendant 10 ans, j’ai joué une partie d’échecs sans savoir que c’en était une.
J’ai cru qu’il me suffirait d’être bonne dans mon job, loyale et fiable.
Mais la vérité, c’est que l’entreprise ressemble moins à une salle de réunion qu’à un conseil de guerre. Le business est un jeu de pouvoir et d’alliances.
Voici un petit précis pour celles et ceux qui sont encore sur l’échiquier et qui veulent apprendre.
L’illusion de la rationalité
Si vous pensez que les décisions en entreprise se prennent froidement et de manière rationnelle, qu’elles naissent des chiffres, des matrices SWOT ou PESTEL, ou encore de l’analyse du marché, vous avez tort.
Les entreprises sont dirigées par l’Homme, et l’Homme est un animal social, qui fonctionne à l’émotion.
L’Homme d’affaires (ou la femme), tout comme le dirigeant politique, n’échappe pas à la peur : peur de l’échec, peur de perdre son territoire, peur d’être évincé. Ce sont ces émotions qui conditionnent ses décisions. Et même les esprits les plus brillants se laissent guider par elles.
Des recherches en neuroéconomie démontrent que 90 % de nos décisions sont dictées par notre cerveau émotionnel, l’instinct écrasant largement la raison.
Selon la théorie des somatic markers d’Antonio Damasio, nos corps réagissent avec un signal émotionnel (douleur, tension, alerte) avant même que l’esprit ne pense. La prise de décision se fait par le corps, pas par la logique.
D’ailleurs, lors de prises de décision importantes, d’échecs ou de conflits, n’avez-vous jamais ressenti vous-même :
- Un battement de cœur qui s’accélère,
- Une montée d’adrénaline soudaine,
- Un mal de ventre,
- L’apparition d’un eczéma,
- Un malaise diffus ?
Cela signifie qu’un homme politique peut dissoudre une Assemblée Nationale par frustration, qu’une dirigeante peut mettre fin à son entreprise florissante par colère, ou qu’un manager peut écarter un collaborateur compétent uniquement parce que ses émotions lui indiquent de le faire.
Or, si vous voulez gravir un échelon, mieux vaut d’abord apprendre à maîtriser vos émotions, et à comprendre celles des autres.
Car tant que vous croirez que tout est question de compétences, vous risquez de rester un exécutant dans l’ombre des performants.
Ce que vous ne voyez pas peut vous détruire
Le monde de l’entreprise est comparable à un échiquier géant… Ou un Game of Thrones moins violent. (Quoique.)

On vous explique que vous êtes là pour bien faire votre travail.
Mais personne ne vous a parlé des règles qui ne sont pas dans le contrat : celles qui sont dans les couloirs, les silences, les actes plutôt que les paroles.
Il ne s’agit pas d’être bon ni d’avoir des compétences.
Ça, tout le monde en a ou peut en avoir.
Le monde du business est une guerre de territoires.
Il s’agit de créer votre propre territoire ou d’être intégré à celui de quelqu’un d’autre.
Et pour cela, il faut apprendre les codes.
Apprenez à écouter les rumeurs, car d’expérience, elles contiennent une part de vérité.
Écoutez également les personnes discrètes qui semblent avoir été évincées.
Car les « perdants » sont souvent ceux et celles qui ont le plus subi, et donc, le plus appris.
Écoutez-les. Ils n’ont plus rien à perdre, alors ce sont souvent les plus honnêtes.
Essayez de comprendre pourquoi l’autre agit ainsi. Quelles sont ses motivations réelles ?
Dans Political Skill at Work: Impact on Work Effectiveness, Ferris, Davidson et Perrewé démontrent que la compétence politique est le facteur le plus déterminant de la réussite professionnelle, bien plus que les compétences techniques ou les efforts.
Ils définissent cette compétence comme la capacité à comprendre les dynamiques sociales, à influencer les perceptions, à s’adapter à ses interlocuteurs, et à le faire avec une sincérité apparente.
C’est un tout un art : lire les jeux de pouvoir, se positionner sans menacer, obtenir l’adhésion sans forcer.
Selon leur étude, les individus qui excellent dans ce domaine :
- Sont perçus comme plus compétents, même à niveau égal
- Accèdent plus facilement aux promotions
- Sont mieux protégés dans les environnements instables
- Et surtout : inspirent confiance, même sans preuve objective de performance.
Il n’y a pas d’amitié en business
J’ai longtemps cru que l’on pouvait tisser de vraies amitiés en business.
Mais c’était une utopie.
Chacun avance pour son propre intérêt, et les relations ne sont pas affectives, mais instrumentales.
Il ne faut jamais confondre affinité et alliance.
(Si vous avez rencontré de vraies belles personnes, tant mieux.
Moi aussi. Mais ne partez jamais du principe que l’affinité protège.
La lucidité, si.)
Car ce que vous croyez être une amitié est souvent une négociation implicite.
Vous êtes accepté parce que vous êtes utile : pour votre travail, votre prestige, votre réseau, votre calme ou vos connaissances.
Et tant que vous êtes utile, vous êtes gardé.
Mais le jour où vous n’avez plus de valeur stratégique, ou pire, le jour où vous dérangez : vous êtes écarté.
Bien sûr, c’est fait dans les règles de l’art : poliment, stratégiquement, à coup de recommandés ou de « merci pour ton travail, mais… ».
Dans leur étude sur la dynamique des coalitions, Ferris et Hochwarter montrent que les relations professionnelles sont façonnées par une logique instrumentale : les individus se rapprochent de ceux qui peuvent faire avancer leur position perçue, non de ceux qu’ils apprécient réellement.
Apprendre les règles du jeu
Les décideurs ne sont pas toujours ceux que vous pensez.
Ce n’est pas celui qui signe qui décide, c’est celui qui influence la main qui tient le stylo.
Contrairement à l’image discrète qu’elle a toujours eu, Bernadette Chirac était redoutée dans tous les cercles chiraquiens, car c’est elle qui a relancé sa carrière après ses défaites, qui a tenu les fidèles, et qui plaçait ses pions avec plus de lucidité que son mari.

Chirac lui-même disait : “Si elle était à ma place, elle irait beaucoup plus vite.” Bernadette était la conseillère non officielle qu’on ne contredisait pas.
En entreprise, les figures du pouvoir sont rarement les plus évidentes.
Parfois, c’est l’assistante de direction.
Parfois, l’épouse, le bras droit discret, l’ami de golf.
C’est toujours celui ou celle qui rend heureux le dirigeant.
Celui qui rend heureux l’autre détient les pouvoirs.
Lorsque vous vous rendez à un afterwork, à une réunion ou sur les réseaux sociaux, observez attentivement :
- Qui fait taire la salle ?
- Qui dérange ?
- Qui provoque des silences ?
- Qui ne s’excuse jamais ?
- De qui parle-t-on même quand il n’est pas présent ?
- Qui protège qui ?
- Qui donne à qui ?
- Qui reçoit sans rendre ?
- Qui donne trop sans retour ?
- Qui se sert de la réussite de l’autre pour son propre crédit ?
- Qui monte quand un autre descend ?
- Qui grimace, qui valide d’un regard, qui ne dit rien ?
je suis certaine que vous avez eu quelques personnes en tête.
Et bien, c’est ça, les jeux du pouvoir.
La personne la plus influente n’est pas celle qui parle le plus,
c’est celle qui place ses pions sans jamais dire qu’elle joue.Et vous, vous devez comprendre ce que chacun veut.
Pas pour manipuler, mais pour ne plus être manipulable.Si vous ne comprenez pas les règles du jeu, soit vous stagnerez très vite face à un plafond de verre invisible, soit vous vous ferez écraser.
Le coût du refus de jouer
Ne pas comprendre la géopolitique d’entreprise, c’est risquer de devenir un pion sans le savoir.
Mais il faut nuancer.
Certains refusent de participer par conscience, par éthique, par refus de compromission ou par fidélité à leurs valeurs.
Ce n’est pas une faiblesse, à condition que ce soit assumé et non subi.
Personnellement, c’est lorsque j’ai compris ces règles du jeu que j’ai décidé de sortir de la partie. J’ai une autre logique, avec d’autres valeurs.
Mais tant que je n’avais pas compris les règles, je les subissais.
Aujourd’hui, je sais : Il n’y a pas de zone neutre si vous voulez monter les échelons.
Voici les principes que je propose comme bouclier :
N’offrez jamais sans stratégie.
J’ai longtemps donné sans espérer d’autre retour qu’un merci ou une forme de reconnaissance. Il y a cet adage qui dit : « Donner pour recevoir. » Suivez-le.
Ce qui est gratuit n’est pas respecté.
Donnez oui, mais sachez pourquoi, et à qui.
Posez vos limites tôt.
Peu importe si la personne est votre patron, un influenceur connu sur les réseaux, un client important… Posez vos limites et imposez vos propres règles immédiatement. Dès le premier écart, communiquez en signalant ce qui vous dérange et pourquoi.
Et si l’autre minimise les faits ou prétend que vous sur-réagissez, c’est peut-être déjà un signal que vous êtes en train de vous faire manipuler, ou au moins, que vous n’êtes pas respecté dans vos besoins et votre système de valeur.
Ne faites jamais confiance aveuglément.
À mes débuts en business, un homme, appelons-le Alfred, m’a fait travailler et m’a recommandé auprès de son cercle.
Grâce à lui, j’ai signé plusieurs contrats intéressants.
Alfred était quelqu’un « d’important » : dirigeant d’une belle start-up, adjoint au maire, influent dans beaucoup de cercles.
Je n’avais rien à lui offrir en retour, mais il était toujours disponible, flatteur, généreux. Je me sentais redevable d’Alfred, alors je me suis pliée en 4 pour lui faire plaisir. J’étais disponible à n’importe quelle heure, j’ai baissé mes tarifs, je répondais à toutes ses demandes… Je croyais à une forme de loyauté partagée, et je lui faisais confiance. Mais c’était un jeu de pouvoir parfaitement rôdé.
La bienveillance peut être un outil, et Alfred était bien plus manipulateur que bienveillant.
Gardez l’oeil sur les dissonances.
Parce que ce que vous prenez pour de la sincérité peut ne pas l’être.
D’expérience, les flatteries gratuites ou les élans de générosité sans explication sont rarement innocents. Parfois, ce sont les préambules les plus polis qui cachent les prises de pouvoir les plus toxiques.
Surveillez la dissonance entre les paroles et les actes, entre les posts publiés et les faits réels, entre les règles qui sont imposées aux autres, et celles qui sont appliquées par celui qui les énoncent… Écoutez les versions de tout le monde, et ne faites jamais confiance aveuglément.
Ce n’est pas une invitation à devenir parano, ou totalement stratège, mais un appel à rester sur ses gardes. Cessez d’être une variable sacrifiable.
Ne confondez jamais gratitude et dette.
Un “merci” ne vous lie pas à vie à une personne.
Si ce qu’on vous a donné exige une loyauté à vie, ce n’est pas de l’aide : c’est un piège.
Ne croyez pas que votre mérite vous protègera.
Le mérite est une illusion confortable.
Mais dans un monde où les égos dirigent plus que les compétences, travailler trop bien peut justement vous rendre dangereux : trop visible, trop brillant, trop indépendant.
Et dans ce cas, on cherchera à vous écarter.
En invoquant une “question de fit”, un “changement de stratégie” ou un “décalage de posture”. Parfois, on dira que vous n’avez pas tenu la pression, et que vous êtes instable.
Si vous n’apprenez pas à défendre votre place, à lire les intérêts, à sentir les glissements… votre excellence deviendra un motif d’exclusion.
Le mérite ne suffit pas.
Il faut aussi maîtriser l’arène.
Mais je ne veux pas laisser croire que tout est à jeter.
Il m’est arrivé aussi de croiser des alliés vrais.
Des personnes discrètes et, justes, qui ne jouaient pas les jeux de dupes, ou qui, comme moi, les avaient subis et refusés.
J’ai aussi appris à dire non.
À refuser des contrats où l’on attendait que je sois charmante, pas compétente.
J’ai augmenté mes prix.
J’ai posé des conditions.
J’ai pris la parole dans des espaces où je pensais ne pas avoir le droit d’exister.
J’ai perdu certains clients.
Mais j’ai gagné du respect, et surtout : je me suis respectée moi.
Ce sont ces moments-là qu’on oublie souvent de raconter.
Ceux où on se relève et où on cesse de se laisser faire.
Et ça, c’est une victoire.
Et si on apprenait tous les codes ?
On ne vous apprend pas ça à l’école.
On ne vous en parle pas non plus quand vous démarrez dans le monde de l’entreprise.
Mais un jour, vous le découvrez.
Un peu tard. Et un peu seule.
Et là, vous avez deux options :
– continuer à croire que le mérite paiera un jour ;
– ou apprendre les règles du jeu.
J’ai choisi la deuxième.
Et maintenant je les transmets à celles qui arrivent sur l’échiquier.
La loyauté comme piège, les silences punitifs, les alliances intéressées, les stratégies de bouc émissaire, les trahisons par intérêt.
Tout cela existe bel et bien dans le monde des entreprises.
Comprendre les règles du jeu, ce n’est pas s’y soumettre.
C’est décider, en conscience, ce qu’on accepte et ce qu’on refuse.
Ce monde ne changera pas tout seul.
Mais il change chaque fois qu’une femme cesse de se taire, dénonce et avance.
“Je ne vous conseille pas le labeur mais le combat.
Que votre labeur soit un combat, que votre paix soit une victoire.”Friedrich Nietzsche – Ainsi parlait Zarathoustra